Recherchez sur le site !
Recherche avancée / SpécifiqueCatégories publications
+ Sciences De La Terre - Archéologie - Astronomie - Spéléologie - Ecologie - Pédologie - Volcanologie - L'hydrogéologie - Géomorphologie - Minéralogie - Pétrologie - Paléontologie - Géologie + Climatologie - Réchouffement climatique - Changement climatique + Plantes - Plantes Aromatiques - Plantes médicinales + Zoologie - Faunes + Botanique - Flors + Sciences humaines - Géo Eco Tourisme - L’anthropologie - L'Histoire - Démographie - Sociologie - Géographie - Patrimoine culturel
Géo éco tourisme inclusif

Géoparc et Recherche Scientifique
Le coins de l’étudiant



Blog Géoparc Jbel Bani
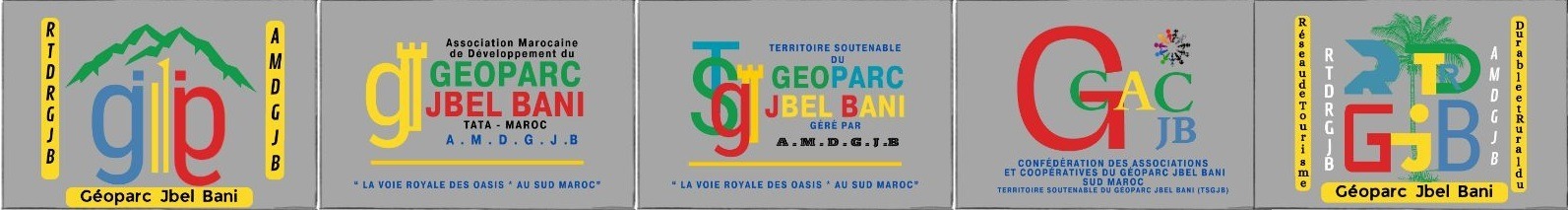
Place Jamaâ El Fna, espace en devenir
Ouidad Tebbaa
Université Cadi Ayyad
Résumé
La Place Jamaâ El Fna a été proclamée patrimoine oral et immatériel de l’Humanité en mai 2001. Depuis 2007, elle a intégré, tout comme les 90 chefs- d’œuvre proclamés par l’UNESCO, la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité mise en place par la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 2003. Quel devenir pour ce patrimoine oral de la place Jamaâ El Fna ? Comment évaluer les enjeux de l’oralité dans le contexte actuel sachant que la Place connaît à l’heure même de la reconnaissance internationale, la désaffection la plus grande et que la chaîne de maître à disciple qui assurait la pérennité de ces savoirs et de ces savoirs faire qui ont fait la gloire de cette place semble comme brisés. Comment dès lors réactiver le désir de transmettre, conformément aux préceptes de la convention de 2003, sur le patrimoine culturel immatériel ?
Près d‘une décennie après la proclamation de la Place Jamaâ El Fna chef-d‘œuvre du patrimoine oral et immatériel de l‘Humanité, se pose de manière de plus en plus pressante la question de la pérennité de son patrimoine dont le paradoxe est qu‘il acquiert un statut officiel, une crédibilité internationale à l‘heure même où ses détenteurs connaissent la désaffection la plus grande et que la chaîne de maître à disciple qui reliait la vieille génération à la nouvelle est brisée.
Ainsi, à l‘heure de la reconnaissance et de la consécration, du désir de sauvegarde de ce patrimoine oral dont ils sont les précieux dépositaires, les conteurs vivent, dans le dénuement le plus total. Le mépris ou la suspicion dont ils sont l‘objet en font les laisser pour compte d‘une société qui reste indifférente au sort d‘un pan fondamental de son imaginaire et de son rapport au monde : celui qu‘elle a développé au fil des siècles à travers l‘oralité et qu‘une histoire multiséculaire faite de transmissions, de filiations, d‘initiations a acheminé jusqu‘à nous…
Alors, les acteurs de la Place Jamaâ El Fna et plus spécifiquement ses conteurs tels Mohamed Bariz et de Abderrahim El Maqouri ne sont-ils que des vestiges d‘un monde voué à disparaître, des « fossiles culturels », dont on doit archiver et conserver les propos ou peuvent-ils accompagner l‘évolution actuelle par leurs pratiques quotidiennes sur la Place ? En réalité, en dépit de ce qui semble la menacer au plus point, la culture écrite et tous les moyens audio-visuels, le patrimoine oral de la Jamaâ El Fna témoigne d‘une vitalité sans pareil. Certes, pour ces acteurs, le défi à relever n‘est plus de même nature que pour leurs prédécesseurs. Comme le souligne Juan Goytisolo, la bataille de la culture orale primaire est, à l‘évidence, perdue d‘avance. En revanche, celle que les conteurs engagent, dans des conditions de plus en plus difficiles, pour une culture orale hybride, est décisive. Elle consiste à intégrer dans son combat cela même qui semble la menacer : les livres.
En effet, aujourd‘hui, l‘attrait de la lecture est essentiel dans le renouvellement de la pratique du conteur. Il ouvre des perspectives illimitées sur des textes inconnus du public. Il permet en outre de donner une vie nouvelle à leurs récits, en télescopant des histoires parfois trop connues…en les enchevêtrant, en brouillant les repères, en modifiant les noms…Un travail d‘intertextualité salutaire pour renouveler l‘intérêt d‘un public friand de nouveauté et que la pratique de la halqa rend plus jouissif encore par la capacité infinie d‘improvisation qu‘elle permet.
C‘est ainsi que se fondant sur telle geste épique ou les Mille et une Nuits ils créent de nouveaux contes où des personnages empruntés à tel univers changent de nom, d‘attribut pour s‘allier, guerroyer, s‘unir à d‘autres personnages très éloignés quant à l‘époque ou l‘origine comme celle d‘Al Malik Sif Bnou Yazal qui, abandonné par sa mère, se retrouve non dans le Palais d‘Al Malik Ifrah, mais dans celui du Pacha El Glaoui, à Marrakech ! Certes, le déroulement de l‘intrigue n‘en était pas pour autant affecté mais le conteur savait mieux que personne, qu‘aucun roi des épopées ne pouvait se mesurer, dans l‘imaginaire du marrakchi, à la figure légendaire du Pacha !
Mais eux-mêmes le reconnaissent, le recours à la culture écrite n‘est qu‘un détour, un moyen pour mieux affirmer la suprématie de la tradition orale, car outre l‘improvisation qu‘elle permet, elle s‘appuie sur une série d‘éléments dont l‘écrit est définitivement dépourvu et que Goytisolo définit comme « un extraordinaire patrimoine immatériel lié à la représentation publique. »
Les conteurs, qualifient cet art de capter l‘attention du chaland, de le séduire, « sihr al bayane ». Il consiste pour eux non seulement à donner vie, forme, consistance à ses personnages, mais à être capable à tout moment d‘impressionner le public, de piquer sa curiosité, de le surprendre, de l‘amuser, de l‘émouvoir, par des moyens divers, souvent non verbaux.
Nulle geste épique n‘a d‘attrait, sur la place Jamaâ El Fna, sans ce fameux « bayane », qui sait conférer à chaque fait son poids d‘émotion, de solennité ou de légèreté.
Mais, de ce point de vue, les conteurs, aujourd‘hui plus que jamais, sont sommés d‘être créatifs précisément parce que leur public abreuvé d‘images, ivre de distractions, est moins réceptif. La métamorphose opérée par la télévision a été, à cet égard décisive puisqu‘elle a altéré, de manière irréversible, le rapport que toute une société entretenait avec sa tradition orale.
Revenons donc maintenant après la vitalité créative des acteurs de la place Jamaâ El Fna à ce qui peut aujourd‘hui, mettre en péril ce patrimoine. On a longtemps décrit ce public particulier de la place Jamaâ El Fna , comme un public d‘autant plus exigeant qu‘il était en phase, toujours prêt à vibrer à l‘unisson dès lors que le talent se manifestait. Pourtant, aujourd‘hui, ce dernier semble plus affairé, plus goguenard…Plus versatile aussi… Il n‘est pas rare, en effet, de le voir butiner ici ou là quelques bribes de récits sans jamais prendre le temps d‘assister à la totalité d‘un spectacle, alors qu‘autrefois, la chose eut semblé inconcevable…
Ainsi, si la place reste apparemment le lieu par excellence du divertissement, ce dernier revêt désormais une forme beaucoup moins recueillie, moins contemplative. Le pacte entre le public et le hlaïqi est comme brisé.
Certes, la place elle-même n‘est pas étrangère à un tel phénomène. En effet, le chassé-croisé des vélomoteurs et des voitures, dont le trafic est certes aujourd‘hui plus réduit, a renforcé la confusion ambiante. Ce tohu bohu pèse de manière significative sur le travail des hlaïqis, de plus en plus confinés dans un îlot fragile, cernés par le vacarme ambiant. La traditionnelle concurrence entre les hlaïqis, autrefois orchestrée de main de maître par l‘Amine et réglementée par un code subtil d‘usages et d‘interdits que tout le monde était tenu de respecter a fait place à une véritable foire d‘empoigne où la lutte fait rage non seulement entre les différents acteurs de la place mais aussi entre « les tenants du bazar » car les intérêts en jeu sont considérables ..
Ainsi, de plus en plus tonitruante, la place est aussi beaucoup plus mercantile : l‘expansion croissante des commerces a peu à peu empiété sur l‘espace même du spectacle. Ainsi, les restaurateurs, les herboristes…supplantent aujourd‘hui largement les conteurs, confinés à la périphérie, exerçant leur métier dans des conditions de plus en plus difficiles où Sihr el bayane ne leur est plus d‘aucun secours, car il ne s‘agit plus de parfaire l‘expression pour convaincre le public, mais d‘élever la voix par-dessus le vacarme ambiant, simplement pour se faire entendre…
En fait, les conteurs notamment se vivent de plus en plus comme les survivants d‘une époque à jamais révolue, les fossiles d‘un âge glorieux dont ils égrènent avec nostalgie, les épisodes marquants, sur le même mode que la geste d‘Antara ou d‘Al Azaliyya…
En fait, étrangers à leur propre univers, dépossédés de cette place dont ils sont encore aujourd‘hui l‘emblème, ils ont renoncé à cela même qui fondent leur survie et la perpétuation de leur art…la transmission de leur savoir.
Jamaâ El Fna « belia », affirment-ils. Certes, ils retrouvent la fierté de leurs débuts quand ils évoquent leur passion de conter, l‘ivresse de la halqa, dont le cercle magique vous prémunit de toutes les contingences, les vicissitudes du réel…Mais rappellent-ils, quand le cercle se brise, les frustrations s‘aiguisent, la vie rattrape celui qui sut, le temps du récit, la suspendre au fil de sa parole.
C‘est que la place n‘est plus à même de leur assurer le minimum de subsistance nécessaire à leur survie, elle profite à d‘autres activités plus lucratives qui, elles, n‘auront aucun mal à se perpétuer.
Protéger le patrimoine oral de la place Jamaâ El Fna, dans le sillage de la proclamation de l‘Unesco nous rappelle donc à l‘impérieuse nécessité de la pérennisation de ce savoir par la réactivation du désir de conter…Seul l‘avènement d‘une nouvelle génération de conteurs, aussi talentueuse que passionnée peut véritablement garantir la survie d‘un tel art.
Qu‘en est-il aujourd‘hui de cette culture orale et populaire, au-delà même de la Place Jamaâ El Fna, comment s‘effectue la transmission de ce savoir ? Depuis quelques décennies, la figure de la conteuse emblématique des veillées familiales et collectives s‘est estompée, détrônée par l‘oralité médiatique de la radio et de la télévision, par l‘écrit tout puissant, par internet aujourd‘hui…La pratique du conte tombée en désuétude ne survit plus que dans quelques souks ruraux, quelques rares moussems et surtout sur la place Jamaâ El Fna de Marrakech…
De même, le modèle même de la transmission du savoir qui prévalait jusque-là a disparu. Pendant des siècles, l‘apprentissage du savoir fut une quête du savoir. Il revêtait la forme d‘une pérégrination tout autant spatiale que spirituelle. Qu‘il s‘agisse d‘enseignement orthodoxe ou de celui plus marginal de la culture populaire, il n‘y avait pas d‘apprentissage sans misère, sans solitude, sans risque, sans vagabondage, sans rupture avec la vie passée, comme il n‘y avait pas de maître, sans filiation. C‘est la raison pour laquelle l‘enseignement était avant tout apprentissage pour l‘élève, mais aussi une forme transmission pour le maître d‘un savoir dont il est le précieux dépositaire.
Dans les figures mythiques de la place Jemaa el Fna, la rencontre du jeune Cherkaoui avec son maître, le vieil aveugle, Ben Feyda, a été une expérience décisive. On raconte, qu‘entre les deux hommes, l‘osmose fut tout de suite, si totale, définitive, qu‘elle perdura bien au-delà de la mort du vieil aveugle, donnant naissance à l‘une des formes les plus originales de spectacle que la place Jamaâ El Fna eut à abriter : la halqa des pigeons.
Plus récemment encore, dans le parcours de Mohamed Bariz et Abderrahim El Maqouri, qui sont les conteurs les plus confirmés de la place aujourd‘hui, on retrouve la même quête de l‘Ailleurs, le même désir de rupture exacerbés par la rencontre de leurs maîtres, figures légendaires de la place Jamaâ El Fna. La fascination que ces personnages exercèrent sur eux, les conduira dans un premier temps à s‘approprier leur style, les mimiques, leur langage jusqu‘au jour, où, impatients de trouver leur propre voie, ils s‘en iront, par les chemins, bravant la faim, la solitude, dans un désir pressant de s‘accomplir.
Aujourd‘hui, hélas, ces conteurs, qui se vivent comme les survivants d‘une époque à jamais révolue se sentent étrangers à leur propre univers, dépossédés de cette Place qui est la leur, ils ont renoncé à cela qui fonde leur survie et la perpétuation de leur art : la transmission de leur savoir.
Comment, dans ces conditions, protéger le patrimoine oral et immatériel dans le sillage de la proclamation de l‘Unesco, qui exhorte à la pérennisation de ce savoir ? La conservation, l‘enregistrement, l‘archivage sont certes, un préalable nécessaire, mais cette démarche, nécessaire, n‘est pas suffisante. Elle nécessite la re- sensibilisation du public à cette culture discréditée et surtout de plus en plus méconnue, par la réactivation du désir de mémoriser voire de conter… A défaut de ce rapport direct, immédiat, qui passe par la régénération de pratiques considérées comme désuètes, toute cette culture encore vivante disparaîtra à jamais.
Les résulats de l‘enquête réalisée à l‘aube de l‘an 2000, sous l‘égide d‘A.
Boukous1 conforte l‘espoir de ce renouveau puisque, contrairement aux idées couramment admises, les jeunes y manifestent un intérêt notable pour la tradition orale, alors que l‘on a coutume de considérer qu‘ils sont enclins à mépriser cette dernière, privilégiant une culture ouverte sur la modernité et transmise par les écoles et les médias.
Il apparaît, en fait, que la majorité d‘entre eux apprécie la tradition orale, souhaite qu‘elle soit collectée et archivée, et surtout qu‘elle soit transmise aux jeunes générations, car ce patrimoine est en danger et il constitue, d‘après eux, un ancrage culturel essentiel, voire un fondement de leur identité.
Quel pourrait être, dans cette perspective, le rôle de l‘école ? Dans quelle mesure celle-ci pourrait-elle participer au travail de perpétuation de cette mémoire ?
Les jeunes révèlent qu‘ils ont une conception purement instrumentale de la culture reçue à l‘école et à l‘université, dans la mesure où celle-ci se réduit, selon eux, à un instrument permettant d‘acquérir des habiletés techniques en vue d‘acquérir un métier ou un diplôme pour l‘emploi. Mais les fondements épistémiques de cette culture scolaire semblent totalement leur échapper. Toujours selon leurs dires, cette culture se réduit à un savoir-faire et n‘influe jamais en termes de savoir-être. Les valeurs qui accompagnent la formation scolaire ne sont
Donc jamais assimilées au point de contribuer à leur enrichissement personnel.
Les jeunes se disent, en outre, conditionnés par la culture scolaire, conditionnement qui se traduit par un parti pris envers la culture populaire, décrite au mieux comme une forme de culture archaïque qui fait partie intégrante du passé, au pire, comme un résidu de culture qu‘il faut éradiquer au nom du progrès.
Ainsi, le système scolaire cherche à ériger la culture qu‘il véhicule en modèle exclusif au détriment de tout autre, érigeant des frontières infranchissables entre l‘oral et l‘écrit et ne mettant en avant qu‘une forme de culture, savante et élitiste, au détriment de l‘autre, populaire et donc supposée dévoyée.
Pourtant, comme le souligne Juan Goytisolo, dans son discours d‘ouverture, à la proclamation des chefs d‘œuvre du patrimoine oral de l‘Humanité, au siège de l‘Unesco, « la culture et l’instruction ne sont pas des termes identiques et c‘est la raison pour laquelle les dépositaires du savoir oral peuvent être et sont parfois beaucoup plus cultivés que certains de leurs contemporains initiés au seul maniement des techniques audiovisuelles et informatiques ».
Il n‘y a pas d‘avenir sans mémoire et l‘on ne peut concevoir une société lobotomisée, coupée de ce qui fonde son substrat culturel, affectif et mental. On ne peut donc qu‘appeler de nos vœux un regain d‘intérêt pour cette tradition orale et populaire et surtout une vision plus généreuse de la culture, par le système scolaire.
Le 31/12/2024
Source Web par : Livre "De l’immatérialité du patrimoine culturel"
Les tags en relation
Dictionnaire scientifique
Plus de 123.000 mots scientifiques
Les publications
Géo parc Jbel Bani

Circuits & excursions touristiques

cartothéques


Photothéques
Publications & éditions




