Recherchez sur le site !
Recherche avancée / SpécifiqueCatégories publications
+ Sciences De La Terre - Archéologie - Astronomie - Spéléologie - Ecologie - Pédologie - Volcanologie - L'hydrogéologie - Géomorphologie - Minéralogie - Pétrologie - Paléontologie - Géologie + Climatologie - Réchouffement climatique - Changement climatique + Plantes - Plantes Aromatiques - Plantes médicinales + Zoologie - Faunes + Botanique - Flors + Sciences humaines - Géo Eco Tourisme - L’anthropologie - L'Histoire - Démographie - Sociologie - Géographie - Patrimoine culturel
Géo éco tourisme inclusif

Géoparc et Recherche Scientifique
Le coins de l’étudiant



Blog Géoparc Jbel Bani
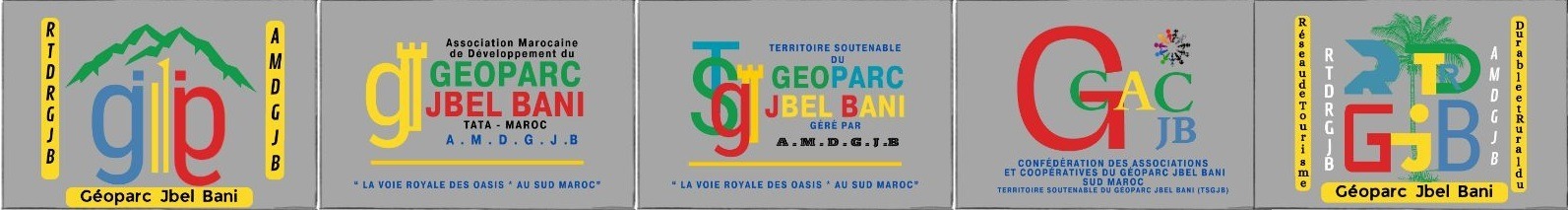
DYNAMIQUE AGRICOLE ET ENJEUX HYDRIQUES DANS LA MOYENNE VALLEE DE DRAA (MAROC) : CAS DE L’OASIS DE MEZGUITA ET SES MARGES
Ait Ali Ahmed Abdeljalil et Daoud Mohamed
Laboratoire REED –FLSH, Université Chouaïb Doukkali El Jadida abdeljalilai@gmail.com
Résumé
Cette étude traite l’évolution des superficies consacrées à la culture de la pastèque dans l’oasis de Mezguita et son impact sur les ressources en eau locales. Pour aborder cette problématique et sans trop investir dans l’évolution de la société et de son milieu, nous nous limiterons ici à mettre en exergue l’interaction entre la dynamique de la production de la pastèque et les ressources en eau disponibles. Ce travail s’est basé sur une approche inductive qualitative (Travail de terrain, entretiens, et focus groupe).
L'étude révèle bien les oasiens ont su s'adapter à leur environnement par une exploitation raisonnable des ressources disponibles (eau, sol et couvert végétal) pour assurer leur survie et une pérennité du système oasien.
L’ouverture des oasis sur leur environnement proche et lointain a entrainé une modernisation du système de production par l’introduction de nouvelles cultures destinées exclusivement au marché (sont pastèque et maraichages). Ces nouvelles cultures sont pratiquées sur de grandes surfaces à l’extérieur des oasis authentiques dites traditionnelles. Les besoins importants en eau de ces nouvelles pratiques agricoles font apparaitre le défi de la préservation de cette ressource.
Abstract
Agricultural Dynamics and the Challenge of Water Security in the Middle Drâa Oases (Morocco): Case Study of the M'zguita Oasis and its Margins
This study aims to monitor the developments in watermelon production in the M'zguita oasis in terms of area and quantity, and their impact on local water resources. To achieve this, we considered the M'zguita oasis as a territorial system where the elements of the population's activities interact with the natural environment, which requires an interactive study of the dynamics of adopting market-oriented products (watermelon production) and the available water resources. To study this phenomenon, a qualitative inductive approach was adopted (direct observation, interviews, focus groups).
The study showed that the oasis dweller has adapted to his environment, overcoming risks and constraints, and making optimal use of water, soil, and vegetation to meet his needs and ensure the sustainability of the oasis system.
He has established a pastoral and agricultural subsistence system based on traditional methods.
With the opening up of the oases to regional, national, and international markets, agricultural production has experienced a dynamic shift from subsistence to market-integrated agriculture.
Farmers have adopted new products that consume more water resources, such as legumes and watermelons, in areas outside the traditional oases.
Introduction
Les oasis du versant sud atlasique du Maroc sont restées fort longtemps en marge des grandes transformations subies par celles du reste de l’Afrique du Nord. L’explication de cette exception réside certainement dans leur colonisation tardive et dans l’absence d’une colonisation agraire, contrairement à celles de l’Algérie et de la Tunisie (Daoud, 2000). Les prémisses des grands bouleversements n’ont commencé à être tangibles que vers la fin des années soixante du siècle dernier. Les interventions étatiques et la mise en applications des différentes stratégies et programmes relatifs aux espaces oasiens ont accéléré le processus de désintégration des structures anciennes et le développement d’autres structures modernes à savoir : Une agriculture moderne basée sur l’exploitation de la nappe phréatique, une urbanisation accélérée, un délaissement des espaces traditionnels. Ces nouvelles tendances sont accompagnées d’une surexploitation des ressources eau accentuée par la sécheresse récurrente. Cette évolution sera mise en exergue par l’étude du cas de Mezguita dans le Draa.
L’agriculture dans l’oasis de Mezguita espace d’étude est dynamisée grâce à la volonté de l’agriculteur d’améliorer ses conditions de vie par l’augmentation de la valeur de ses produits agricoles. L’agriculture oasienne est passée donc, d’une production familiale traditionnelle à une production moderne axée sur le marché national et international. L’agriculteur local a introduit de nouveaux produits, tels que, les pastèques, en adoptant des moyens de production modernes (tracteurs, pompage, irrigation localisée, produits phytosanitaires, etc.).
Parallèlement à l’extension des zones de pastèque dans l’oasis de Mezguita, les installations touristiques ont connu une progression importante. La modernisation de l’agriculture, le développement touristique et l’accroissement démographique ont provoqué une pression accrue sur les ressources en eau et ont changé les paysages oasiens. Cette pression sur la ressource en eau et sa surexploitation conjuguées à la sécheresse récurrente et l’écoulement par intermittence de l’oued ont impacté la réalimentation de la nappe. Ceci se manifeste de plus en plus dans le déséquilibre entre les besoins en eau et les ressources disponibles. Ce constat de déséquilibre prend toute sa dimension dans un espace caractérisé par la rareté des ressources hydriques (précipitations rares, écoulement éphémère, températures élevées, vents desséchants, etc.). La préservation des ressources en eau et la garantie de sa durabilité constituent des défis à relever. Pour ce faire, l’adoption de stratégies de développement qui intègrent la dimension environnementale locale dans toute planification locale peut bien assurer une certaine revitalisation des oasis.
1. Problématique et méthodologie
1.1. La problématique
L’introduction de nouveaux systèmes de production dans le secteur agricole a créé une nouvelle dynamique qui se manifeste dans une transition de l’agriculture vivrière vers une agriculture moderne orientée vers le marché. Cette dynamique, qui s’est accompagnée de profondes transformations socio-économiques a eu des répercussions sur l’environnement, notamment, les ressources en eau. Les crises liées au manque d’eau sont fréquentes pour ne citer que celles de 2001, 2009, 2012 et d’autres plus récentes.
La garantie d’une activité agricole durable et la préservation des ressources est un exercice difficile qui exige de jongler avec les besoins croissants et les ressources disponibles de plus en plus réduites et insuffisantes. L’équation entre les besoins croissants et les disponibilités en eau qui s’amenuisent nécessite l’adoption de stratégies de développement qui prennent en considération l’impact sur l’environnement. Ceci constitue donc la problématique de cette étude. La problématique se focalise sur le défi d’équilibrer entre la croissance de la production de la pastèque ou d’autres productions alternatives à valeur ajoutée élevée avec les ressources en eau disponibles.
- quelles sont les caractéristiques de la production agricole traditionnelle dans l’oasis de
Mezguita ?
- comment la pastèque a été introduite ? et quelle est l’évolution des superficies qui lui sont
consacrées ?
- quels sont les impacts de la croissance de la production de la pastèque sur l’environnement
oasien ?
1.2. La méthodologie
Pour mener à bien cette étude, nous avons adopté une approche inductive nous permettant d’analyser les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’évolution de cet espace (oasis de Mezguita) :
- nous nous sommes basés sur un travail de terrain et sur les résultats des études que nous avons réalisés entre 2016 et 2020. En effet, l’observation et les interviews individuelles (22 entrevues) et quatre interviews de groupe (focus group) constituent l’ossature de l’étude ;
- pour recueillir les points de vue de la population sur la croissance de la culture de la pastèque et ses effets sur les ressources en eau, nous avons adopté une approche géographique qui vise à décrire, à analyser et à prospecter ses implications sur le l’eau. Cette approche constitue un moyen approprié pour parvenir à des conclusions qui contribueront à répondre aux questionnements principaux de la problématique ;
- des outils ont été utilisés pour comprendre et analyser les zones oasiennes, en particulier les images satellitaires pour les années 2000 et 2017 dans le cadre du programme de SAS planète et la carte topographique de la région d’Agdz de 1978 et son traitement avec le programme Arcgis. Les relevés sur le terrain sont effectués pour accompagner et compléter le travail cartographique.
1.3. Les objectifs
L’étude relative à la dynamique créée par à la production de la pastèque dans le Draa et particulièrement dans l’oasis de Mezguita, vise à analyser le développement de l’agriculture oasienne et son impact sur le système oasien. Cela, justifie la nécessité d’adopter des stratégies intégrées susceptibles de la surexploitation des ressources hydriques et de faire face aux changements climatiques et leur impact. La dimension de cette étude nous permet aussi de mieux comprendre les aspects de l’évolution de la production agricole traditionnelle, l’évolution de la superficie et de la quantité de la production de la pastèque dans la zone d’étude et la problématique de sa pérennité.
1.4. Espace d’étude
Mezguita fait partie du chapelet d’oasis qui longent le Draa. Elle est située dans la vallée moyenne et relève de la province de Zagora (Région de Draa-Tafilalet). Elle est divisée en cinq communes rurales (Tensift, Mzaguita, Aflandra, Afra) et une commune urbaine : Agdz. (fig.1). L’oasis de Mezguita a une superficie cultivable d’environ 3000 ha en 2020. Elle est structurée et dominée par le centre urbain d’Agdz.
Figure 1. Localisation de l’oasis de Mezguita et ses marges.
Source : Carte élaborée à partir des données de la carte de l’aménagement du territoire et celle du numérique d'élévation du Maroc.
2. La Production agricole traditionnelle : facteurs et caractéristiques
2.1. Le facteur eau structure la production agricole dans l’oasis de Mezguita
L’oasis de Mezguita s’inscrit dans le climat semi-aride du Sud-est du Maroc. Ce climat se caractérise par une pluviométrie faible en intensité et irrégulière dans le temps et dans l’espace. La continentalité et son ouverture sur le désert rendent les écarts de températures importants et sont accentués par des vents chauds de l’Est et du Sud-est.
2.1.1. Des températures variables marquées par la continentalité
L’oasis de Mezguita est caractérisée par d’importantes variations thermiques entre les températures maximales et minimales (fig. 1). La région est connue pour ses températures élevées pendant l’été (430) et basses en hiver (1°). Les températures enregistrent des variations quotidiennes allant de 450 à 470 pendant la journée et chute à 260 pendant la nuit durant la saison chaude et se situe entre 100 pendant la journée et 10 pendant la nuit durant l’hiver. Cet espace assujettis aux températures élevées, connait un taux d’évaporation important, surtout pendant la saison d’été, ce qui accroit la pression sur les ressources en eau destinées à l’irrigation.
Figure 2. Températures moyennes mensuelles à la station de Zagora (1963 et 2017). Source : Compilation des données de l’ORMVAO
2.2.1. Des précipitations modestes et espacées
Il convient de souligner que les précipitations dans les oasis sont extrêmement faibles. Elles ne dépassent pas en moyenne 60 mm à Agdez. La variabilité inter et intra annuelle de ces précipitations est significative, 130 mm pendant l’année pluvieuse de 1978/1979 et 9 mm pendant l’année agricole 1982/1983 pendant la sécheresse des années 1980.
Les précipitations sont rares et souvent sous formes d’averses courtes et violentes. Elles connaissent des variations saisonnières et interannuelles très importantes. Elles sont concentrées pendant l’automne (30 mm) et diminuent dans le reste de l’année pour n’atteindre que 7 mm en été. Le mois d’octobre est le mois le plus pluvieux avec 12mm. Elles demeurent aussi fluctuantes pendant les mois des deux saisons d’hiver et du printemps. Les quantités de précipitations les plus basses sont celles de l’été avec moins de 0,5 mm au mois de juillet (fig. 3).
Figure 3. Les précipitations moyennes mensuelles dans l’oasis de Mezguita entre 1963 et 2017. Source : compilation des données de l’ORMVAO
La volonté de développer une agriculture grande consommatrice d’eau se met en porte-à-faux avec la complexité des conditions naturelles d’un milieu aride et dénudé. Le développement de nouvelles exploitations dont la pérennité est incertaine et la dégradation des oasis traditionnelles n’est plus à démontrer. En effet, ce paradoxe réside dans cette volonté d’introduire des cultures lucratives comme la pastèque, grande consommatrice d’eau. La recherche de gains dans cette activité accentue davantage la vulnérabilité de cette zone aux ressources imitées, subissant doublement la menace par la sécheresse et par la surexploitation.
2.2. Une activité agricole traditionnelle en régression
Le parcellaire de l’oasis de Mezguita chevauche avec la zone d’habitat et se concentre dans de petits terroirs. Ce filet de verdure en chapelet contraste avec le reste de l’espace dénudé en partie non propice à l’activité agricole (fig. 4) et exploité comme pâturage. Anciennement établies, les populations oasiennes vivent en harmonie avec leur milieu par l’adoption d’une activité agricole bien adaptée aux conditions naturelles locales et ses aléas. Ces espaces agricoles qui sont une création de l’homme nécessitent une organisation rigoureuse et un savoir-faire hérité et amélioré au fil du temps. L’ingéniosité des oasiens dans la gestion des ressources montre bien sa capacité à maitriser l’économie de la rareté. Il a établi une économie basée sur une variété de produits qui répondent à ses besoins fondamentaux. Cette organisation explique en grande partie l’équilibre traditionnel entre le facteur humain et celui des ressources naturelles limitées.
Figure 3. La palmeraie traditionnelle de l’oasis de Mezguita.
2.2.1 Un espace agricole traditionnel exigu
Les espaces agricoles traditionnels de Mezguita ne représentent que 2,3 % soit 2440 ha sur une superficie totale des cinq communes estimée à 251600 ha.
L’oasien a toujours pratiqué une polyculture vivrière d’autoconsommation lui permettant de répondre à ses besoins tout en préservant les ressources en eau par la création d’un système d’irrigation traditionnel complexe. Celui-ci est composé d’Ougoug de Sguia et d’un réseau de séguia secondaires et de canaux d’irrigation aux dimensions variables. L’eau de l’oued Draa permet d’alimenter les séguia et de réalimenter la nappe phréatique. L’oasis de Mezguita combine plusieurs cultures à savoir, les dattes, les arbres fruitiers, les légumes, les céréales, la luzerne, etc.
La production agricole est diversifiée, elle est dominée par celle des dattes (82%). suivie par celles des cultures au sol (17%) en fonction des disponibilités en eau d’irrigation. Les arbres fruitiers sont de moindre importance avec seulement 1% de la production. Cette répartition nous montre que l’oasis est principalement composée de deux strates, celle du palmier et celle des cultures sous-jacentes. La strate arboricole est moins importante comparativement au palmier. Elle est composée de rosacés généralement concentrés dans les jardins clôturés (Jnanat ou Ourtane). Plus résistant au manque d’eau, le palmier sert d’ombre aux autres cultures et réduit l’évaporation et comparativement aux autres arbres. Les cultures au sol sont liées directement à l’irrigation.
|
Produit Quantité |
Dattes |
Arbres fruitiers |
Cultures sous-jacentes Production |
totale |
|
Production en Qx |
66053 |
212 |
13879 |
80144 |
|
Pourcentage % |
82 |
1 |
17 |
100 |
Tableau 1. Production moyenne annuelle de l’agricole traditionnelle dans l’oasis de Mezguita pour la période 2006-2016.
Source : compilation des données de l’ORMVAO
2.2.2. Un maigre espace pastoral
L’espace pastoral s’étend sur les conforts de l’Anti-Atlas nord et ouest qui surplombent l’oasis de Mezguita avec des altitudes de plus de 1000 mètres et sur le bord de la vallée dans de petites dépressions, des glacis ou dans des zones escarpées. Ce sont des zonés érodées et à faible couvert végétal (fig. 4).
La zone de parcours couvre une vaste superficie de plus de 97,7% de la zone d’étude avec une végétation éparse composée de plantes épineuses comme les acacias et le jujubier. Ces parcours profitent aux troupeaux de caprins et d’ovins avec une gestion dans le respect des coutumes. En effet, ils sont organisés conformément aux coutumes et conventions intra groupe ethnique (conventions organisationnelles), ou aux lois coutumières entre les groupes ethniques (conventions de réconciliation après des litiges). Les lieux et le temps d’exploitation des pâturages sont définis au préalable, afin d’éviter les conflits qui peuvent survenir entre les tribus (Aït Sedrat, Ouled Yahya). Avec le déclin des parcours, les animaux (ovins et bovins) sont nourris principalement dans des étables. Le bétail des oasiens sédentaires est devenu dépendant des restes des produits agricoles (déchets de dattes, feuilles de palmiers, paille etc.), des plantes fourragères et des aliments composés achetés sur le marché.
Les données de la figure 5 nous informent sur le développement de l’élevage dans l’oasis de Mezguita. Les oasiens ont toujours associé l’activité agricole à celle de l’élevage. Les possibilités de profiter de l’aide et de l’assistance des services de l’ORMVAO et de celle de l’Association Nationale Ovine et Caprine (ANOC) ont entrainé une nette progression de l’élevage dans les étables et particulièrement celui des ovins et des bovins.
Le nombre croissant de bovins et d’ovins s’explique aussi par un changement structurel dans la conduite du bétail. L’abandon progressif de l’habitat ksourien et le recul de l’activité agricole traditionnelle s’est traduite par l’apparition d’éleveurs qui pratiquent un élevage moderne, dans des étables, bien conçues pour répondre aux exigences de la bonne conduite du bétail.
Figure 4. Evolution du cheptel dans l’oasis de Mezguita (2007-2016). Source : compilation des données de l’ORMVAO, 2018.
2.2.3. Une irrigation dépendante des ressources en eau souterraines
L’irrigation des nouveaux espaces aménagés et même de certaines parties des palmeraies est indépendante du système d’irrigation traditionnel. Ce dernier est en nette régression suite aux sècheresses récurrentes ayant entrainé la réduction des lâchers du barrage Al Mansour Addahbi. Bien que les agriculteurs profitent des eaux du système traditionnel, quand les eaux sont disponibles, les espaces aménagés sur les lisières des palmeraies sont pratiquement irrigués à partir des stations de pompage (fig. 4). Les exigences en eau des maraichages et de la pastèque ont entrainé une multiplication des puits et des forages (tab. 2).
Bassin réservoir d’une station de pompage. Cultures sous plastique dans les marges désertiques. .
Figure 6. Mise en valeur des terres collectives dans l’oasis de Mezguita.
La multiplication des puits et des forages équipés montre bien le degré de rabattement sur les ressources en eau souterraines pour répondre à une nouvelle activité agricole grande consommatrice d’eau dans des espaces désertiques.
|
Année |
Puits traditionnels |
Forages |
|
2000 |
1655 |
45 |
|
2008 |
2139 |
71 |
|
2014 |
2450 |
125 |
|
2017 |
2737 |
288 |
Tableau 2. Evolution des puits dans l'oasis de Mezguita entre 1976 et 2017. Source : enquête de terrain, 2017
Le creusement des puits et des forages équipés date depuis les sècheresses de la fin du siècle dernier. L’exploitation de la nappe phréatique est bien le signe avant-coureur de l’intégration de l’activité agricole dans l’économie dominante. En effet, les investissements dans des stations de
pompage sont logiquement suivis de l’orientation des productions vers le marché. Ceci, dans un objectif d’amortir le capital investi et de dégager des bénéfices pour améliorer les conditions de vie. De ce fait, l’activité agricole est intégrée en amont de la production (capital investi) et en val (la commercialisation).
Les puits et les forages sont sujets aux moyens financiers et à la profondeur de la nappe. Nous distinguons deux principales catégories :
- des puits équipés avec des motopompes qui fonctionnent avec de l’énergie fossile (carburant et gaz). A titre indicatif, l’équipement de ce type de stations varie entre 2000 dh à plus de 40000dh. Le coût du fonctionnement varie entre 5 à 15dh l’heure en fonction de la puissance de la motopompe et de la profondeur du puits ;
- des puits et des forages équipés avec des stations de pompage à énergie solaire. Seuls ceux disposants de moyens financiers issus de l’émigration ou des subventions de l’Etat (Plan Maroc Vert) n’hésitent pas à investir dans cette irrigation à énergie renouvelable. L’irrigation évolue elle aussi par l’adoption et le développement de l’irrigation localisée.
3. Modernisation de l’agriculture et introduction de la pastèque
Les sècheresses prolongées ont bouleversés les systèmes oasiens dans leur globalité. Le recul de l’activité agricole traditionnelle qui ne répond plus aux besoins des populations locales, en est la parfaite illustration. Le rabattement sur la nappe reste l’unique alternative pour ceux qui restent encore attachés à la terre. Ils se trouvent donc, dans l’obligation de produire aussi pour le marché. Les lisières des palmeraies et le lit majeur de l’oued Draa permettent d’aménager des exploitations ou de grandes parcelles. Cette option a de multiples avantages dont :
- la possibilité d’avoir un seul puits ou forage ;
- avoir une exploitation ou une grande parcelle assez rentable en matière d’investissement et de rentabilité ;
- habiter dans l’exploitation pour une meilleure présence et un gain de temps ;
- orienter la production vers le marché ;
- la création de ces nouvelles exploitation par extension ont permis de diversifier la production agricole comme les maraichages et particulièrement la pastèque. Ces cultures saisonnières assurent une occupation des sols et des gains immédiats comparativement à l’arboriculture et le palmier dattier qui mettent du temps pour produire.
Le paradoxe de ces extension est l’introduction de la pastèque, hydrovore, dans ces zones dénudées et arides. Auparavant, la culture de la pastèque est une activité traditionnelle ancienne mais peu répandue et surtout destinée à la consommation familiale. Seul le peu de surplus dégagé est orienté vers les souks locaux.
3.1. Productions diversifiées : de la bhira aux exploitations de maraichages
La modernisation de l’agriculture et l’ouverture plus poussée des oasis sur le marché ont créé une dynamique qui a bouleversé les structures socio-spatiales et économiques des oasis. Les terroirs dits traditionnel se dégradent et ne répondent plus aux besoins des populations. Comme dans toutes les oasis du Sud-est, la désolation règne et les paysages des palmeraies verdoyants sont menacés de déchéance. Doublement menacés par la sécheresse et par les incendies de plus en plus récurrents poussent la force de travail encore disponibles à l’émigration (Daoud, 2019). Les populations encore bien attachées à l’oasis investissent dans les nouvelles extensions dont la production est destinée au marché. Ce processus est justement favorisé par les rentrées d’argent de l’émigration. D’autres activités annexes à l’agriculture se sont développées parallèlement à l’intégration de l’agriculture. Ces nouvelles activités sont multiples et concernent les services comme le transport, la vente des engrais, des produits phytosanitaires, du matériel agricole et d’irrigation, les pièces de rechange, la mécanique et la réparation du matériel, les services bancaires, etc.
La demande accrue en équipement et en matériel agricole a contribué à la l’implantation d’entreprises, spécialisées dans le commerce des moyens de production agricoles. Elles n’hésitent pas à recruter des agents pour leur marketing et pour vulgariser les nouvelles techniques. Elles complètent l’encadrement des services de l’ORMVAO. Afin de promouvoir leurs produits, ils offrent des facilités d’acquisition et de payements aux producteurs. Le passage d’une agriculture traditionnelle d’autoconsommation à une agriculture capitaliste est bien entamé.
Dans le passé, la bhira, dite potager familial est constituée de plusieurs récoltes selon les saisons. Ces cultures sont bien disposées dans de petits rectangles appelés Guemmoun, de manière à économiser l’effort et l’eau nécessaire à la conduite des cultures. Elles sont bien soignées et bien entretenues. Actuellement, la bhira a cédé la place à de grandes parcelles et exploitations de monoculture. L’oasien a bien gardé ses habitudes ancestrales héritées dans le domaine agricole ce qui lui a facilité de se lancer dans des productions exclusivement destinées au marché. Sa maitrise des techniques culturales lui ont permis de s’adapter à l’agriculture moderne et aux circuits du marché.
La production pour le marché ne se limite pas seulement à la pastèque mais concerne bien le reste des maraichages et les plantes fourragères (fig. 5). Les cultures maraichères se sont bien développées suite à l’augmentation de la demande. La croissance urbaine et la disparition des Bhira traditionnelles ont amené les populations urbaines et rurales à s’approvisionner sur les souks. Les possibilités de vendre localement ont deux avantages majeurs :
- éviter les intermédiaires et économiser sur le transport ce qui est profitable au producteur ;
- le consommateur s’approvisionnement en produits frais et à moindre coût.
Certaines productions comme celles des carottes et des citrouilles se vendent généralement dans les souks de la province.
|
Figure 5. Cultures irriguées, avec le système du goute à goute, déstinées au marché dans le bassin de Tifrenete.
3.2. Développement de la production de pastèque dans l'oasis de Mezguita et ses marges 3.2.1. L’introduction de la pastèque
Les terres collectives exploitables à des fins agricoles sont devenues l’eldorado des investisseurs locaux et nationaux. Ces terres dénudées avec des sols peu évolués étaient exploités comme parcours par des pasteurs ou semi-nomades dont le cheptel se composait de caprins, d’ovins et de camelins. Ces espaces sont transformés en petite et moyenne exploitations destinées à la production de plantes fourragères, de légumes et surtout de la pastèque. Cette dernière a supplanté le palmier dattier en termes de valeur ajoutée.
Les nouvelles orientations de la politique étatique dans le domaine agricole, matérialisées par le Plan Maroc Vert (PMV), ont ouvert la voie à d’importants investissements dans la mise en valeur des terres collectives. Les subventions varient entre 80% à 100% du capital investi en fonction des superficies. L’appui de l’Etat concerne l’équipement et le processus de production en amont, à savoir, la préparation des terres, l'irrigation localisée, le forage de puits, l'achat de machines agricoles, etc.
3.2.2. Les marges des oasis dominées par la production de la pastèque
Comme évoqué, les extensions se sont faites sur le lit majeur de l’oued Draa ou sur les lisières des palmeraies (fig. 7). Ces premières extensions sont strictement privées, dans la mesure où elles constituent le prolongement des parcelles vers le lit majeur ou vers l’extérieur de la palmeraie. La pastèque s’est développée beaucoup plus sur les terres collectives. Les ayants droits disposants de moyens et des locataires venus des différentes régions du pays (Sous, Doukkala, Haouz etc.) ont investi dans la culture de la pastèque devenue une activité lucrative.
Figure 7. Zones de production de la pastèque dans l’oasis de Mezguita
Source : A.Ait Ali et al. d’après Sasplanet Satellite Visuals 2017 et recherche sur le terrain.
3.2.3. La production de la pastèque d’un cycle cours à un cycle prolongé
La production de la pastèque, faisait partie du système de production agricole traditionnel comme culture de printemps, va voir sa durée prolongée grâce aux nouvelles techniques culturales. En effet, les producteurs ont prolongé la période de production par l’adoption de moyens modernes comme, les cultures sous plastiques, les semences sectionnées (Variétés à Haut Rendement ), les engrais, les produits phytosanitaires, l’irrigation localisée, etc. La production se fait en deux périodes et donc permet deux récoltes légèrement décalées :
- la première commence pendant la dernière semaine de décembre et le processus de récolte
du produit commence à partir de la première semaine d'avril et se poursuit jusqu'en mai ;
- la deuxième intercalée, commence à partir de la deuxième semaine de février et la phase de
récolte commence pendant la dernière semaine de mai et se prolonge jusqu'en juillet.
Tableau 3. Cycles de production de la pastèque.
Source ; enquêtes sur le terrain, année agricole 2020-2021
3.2.4. Le soutien étatique un tremplin pour l’essor de la culture de la pastèque à Zagora
Encouragés par les subventions de l’Etat dans le cadre du PMV vert et les entrées d’argent de l’émigration, la culture de la pastèque va s’accroitre. Sa progression fulgurante est due aussi aux conditions climatiques favorables surtout en termes de températures. Ces dernières, assez élevées permettent une maturation rapide comparativement aux autres régions productrices du Maroc. Grace à sa qualité et à son arrivée précoce sur le marché, la pastèque de Zagora va envahir dans un premier temps le marché national et portant des gains non négligeables pour les producteurs.
Croissance de la pastèque sous plastique. Arrivée à maturation.
Figure 8. Champs de pastèque dans l’oued Tansifte. Source : Crédits, A.,Ait Ali Ahmed (2019-2020)
Depuis le début des années 2000, Zagora est devenue l’une des régions majeures productrices de la pastèque au niveau national. La ruée vers Zagora pour investir dans la pastèque est comparable à celle du palmier dattier dans la province d’Errachidia (Axe Boudnib-Meski) et son prolongement vers Errachidia et Goulmima (Daoud 2019).
Le PMV et le processus de location des terres collectives à moindre coût conjugués aux conditions climatiques favorables sont un catalyseur dans le développement de la pastèque. Les possibilités d’investir et les ressources en eau souterraines disponibles dans un premier temps ont
12 Geomaghreb, numéro 20, année 2024
contribué de façon substantielle à attirer des investisseurs et des entreprises à la recherche d’occasions fructueuses tout en profitant des subventions étatiques.
La variété de pastèques la plus répandue est sans conteste la pastèque rouge. Elle se distingue par sa qualité et son rayonnement national et international. En plus de cette variété, le melon ananas et jaune sont moins répandus et généralement destinés au marché local. Les superficies consacrées à la pastèque sont en nette évolution jusqu’en 2019. Les superficies ont nettement progressé avec le PMV (fig.9). Les superficies de la pastèque ont connu trois phases bien distinctes :
- une première phase avec une progression constante mais assez lent entre 2006 et 2011 avec
respectivement 26ha et 43ha ;
- une deuxième très importante qui a coïncidé avec les gros investissements dans le cadre du PMV. Cette phase de 2012 à 2018 s’est caractérisée par une croissance exponentielle des superficies de la pastèque qui sont passées respectivement de 100ha à 189ha ;
- une dernière phase avec une nette réduction ou plutôt une chute des superficies réservées à
Source : Compilation des données de l’ORMVAO et enquêtes de terrai
la pastèque. Elles sont passées de 189ha en 2018 à moins de 110ha en 2021.Figure 9. Evolution des superficies réservées de la pastèque dans l’oasis de Mezguita entre 2005-2006 et 2020-2021.
La surexploitation prolongée de la nappe phréatique s’est traduite par la baisse du niveau piézométrique. La sécheresse prolongée a induit une situation ambivalente : d’un côté, une surexploitation des ressources en eau et de l’autre la non réalimentation de la nappe. Cette situation a impacté les superficies de la pastèque. L’évolution de la production de la pastèque (fig. 10) peut bien être superposée à celle des superficies. En effet, la production est passée de 1560T en 2006 à 6000T en 2012. La production, a connu son maximum en 2018 avec 11340t pour chuter à 6800 en 2021.
Figure5. Evolution la production de la pastèque dans l’oasis de Mezguita (2006 2021). Source : Compilation des données de l’ORMVAO et enquêtes de terrain
Le coût de la production varie selon les périodes soit environ 40000dh/ha pour la première période suite aux basses températures en janvier et 15000dh/ha pour la deuxième période qui se caractérise par des températures plus élevées et donc un moindre coût.
Il est à noter que la production de la pastèque offre des bénéfices allant de 25000dh/ha à 50000dh/ha. La production de la pastèque booste le marché de travail d’une façon non négligeable et particulièrement pendant la compagne de ramassage. Ce travail saisonnier offre aux travailleurs un salaire journalier qui varie entre 120dh/j à 200dh/j en fonction de l’offre et de la demande liée à la maturation et au ramassage de la production.
Ramassge de la pastèuqe. Vente de la pastèque au marché de gros à Marrakech.
Figure 11. La pastèque, du champ au marché de Marrakech (clichés : Ait Ali Ahmed (2019-2020).
4. Problématique de la ressource en eau
Les nouvelles extensions ont contribué à un développement agricole et économique dont la durabilité est incertaine. Parallèlement à la croissance des secteurs à pastèque, les populations continuent d’exploiter tant bien que mal les palmeraies traditionnelles. Dans les deux cas de figure, le pompage reste le principal moyen de mobilisation des eaux d’irrigation. Quelques khettara sont encore fonctionnelles dans la zone d’Agdez. La pénurie d’eau d’irrigation se fait de plus en plus sentir et se répercutent sur la production de la pastèque comme susmentionné et sur l’approvisionnement des populations en eau potable.
4.1. Produire de la pastèque ou préserver la ressource en eau ?
Des discussions sont menées dans la presse et au sein des associations sur l’impact de la production de la pastèque sur la nappe et sur l’environnement d’une manière générale. Ces associations de protection de l’environnement ou autres œuvrent même pour bannir la pastèque. Mais, les études académiques relatives à l’agriculture dans les oasis ne s’accordent pas sur le bannissement de la pastèque (Bounar et al., 2021). Certaines études avancent que la pastèque consomme bien moins d’eau (5000 à 6000m 3 d’eau/ha/an) que certaines cultures au sol comme la luzerne 18000m3 d’eau/ha/an ou le palmier 12000m3 d’eau/ha/an (Baheni, 2016 ; Ait Ali Ahmed et al., 2019).
Il est vrai que la nappe dans son état actuel est assez réduite par la concomitance de la surexploitation et de la sècheresse prolongée. De ce fait, le problème réside dans les superficies cultivées qui dépassent 6000ha alors que le seuil supportable par la nappe ne doit pas dépasser 3000ha.
En raison de la sécheresse, de la réduction drastique du taux de remplissage du barrage Al Mansour Addahbi et leur corollaire et la pénurie d’eau potable pour les populations urbaines et rurales, les services publics, au niveau de la province de Zagora sont intervenus pour remédier à cette situation. Pour atténuer la pénurie d’eau potable, par deux fois, les services provinciaux sont intervenus par :
- la limitation de la superficie consacrée à la pastèque à 3ha par famille en 2020-2021 ;
- la limitation des superficies de la pastèque à 0.5ha avec un seuil de 1ha par parcelle ;
- l’interdiction de cultiver la pastèque à proximité des puits d’eau potable et à côté du lit de
l’oued.
4.2. Sècheresse et pénurie d’eau potable
Les populations de l’oasis de Mezguita souffrent de façon chronique du manque d’eau potable. Elles s’alimentent habituellment en eau à partir des puits, des séguia, des khettara et de l’oued.. Les pénuries répétitives sont exacerbées pendant les années sèches du fait de la baisse du niveau piezometrique des puits et du tarissement même d’autres. Afin d’assurer une alimentation des populations en eau, les services concernés ont adopté une approche inclusive en associant la société civile et l’Organisation Belge de Coopération pour la création d’associations d’usagers d’eau potable. Ces associations ont pu alimenter tous les ksour de l’oasis en eau potable entre 1998 et 2007 grâce à des réservoirs d’eau reliés à des puits situés à l’intérieur de chaque ksar.
Malgré les efforts concentis, les acteurs de gestion de l’eau potable ne parviennent pas à erradiquer la pénurie d’eau. La croissance démographique (15 556 hab en 1971 et 47 061Hab en 2014 (RGPH de 1971 et de 2014)) et la demande accrue, due aux mutations des modes de vie des populations locales, limitent l’efficacité de la gestion de l’eau potable.
Comme l’illustre la figure 9, la pénurie d’eau n’est pas uniforme dans tous les ksours. Elle varie selon la cohesion sociale de la localité (chaque ksar est composé de divers groupes ethniques, tels que, Daroua, Ait Atta, Aït Sedrat, Ouled Yahya, etc.), et selon la profondeur de la nappe et le niveau organisationnel de l’association qui gère l’eau potable. Les ksours dont les puits son taris se trouvent dans l’obligation de creuser de nouveaux puits parfois dans la palmeraie. Des litiges apparaissent parfois quant à l’emplacement des puits (site, proximité, etc.). Seul un retour à des conditions climatiques assez favorables peut permettre un approvisionnement régulier en eau potable ou par prospection par forage très profonds.
Figure 9. Pénurie d’eau potable dans les ksour de Mezguita Source : enqéte de terrain, août 2018- 2020.
Conclusion
Comme le reste des oasis, celle de Mezguita a subi d’importante transformations à tous les niveaux. Comme dans le passé, l’eau reste le facteur déterminant dans ces changements et leur évolution. L’équilibre entre les besoins et l’eau disponible est renpu remettant en cause les clivages anciens. Les discours sur la preservation du patrimoine oisien confirme bien les bouleverseùments qui marquent la société et son espace. Ceci est bien perceptible dans les structures sociales et dans les payasages (habitat, nouvelles exploitations, extensions, systèmes d’irrigation, etc.) ainsi que par la production pour le marché.
L’économie oasienne se caractérise par une certaine dualité entre une activité oasienne de subsistance et une autre moderne, destinée au marché avec un effet d’entrainement sur les autres activités (moyens de production, services, emplois rémunérés, activités touristiques, etc.).
Le développement de la pastèque est bien lié à la disponibilité en eau. Il est tout à fait normal, qu’en cas de sècheresse prolongée, c’est tout le système oasien qui est impacté. Il est difficile de se prononcer sur les conditions climatiques, mais il est possible de limiter des seuils de superficies destinées à la culture de la pastèque.
Les avis sur l’introduction et le développement de la culture de la pastèque diffèrent en fonction des intérêts des uns et des autres. Si les comparaisons sont probantes, le débat continu et les arguments des uns et des autres ne manquent pas. La seule certitude est bien la pénurie d’eau potable dans bien des ksour, que certains justifient exclusivement par la sècheresse prolongée et généralisée.
Le développement de l’activité agricole durable peut bien contribuer à fixer les populations dans les oasis et partant limiter l’émigration, voir même tirer profit du retour des émigrés qui désirent investir dans les différents secteurs de l’économie locale (agricole et extra agricole).
Références
Ait Ali Ahmed Abdel Jalil et Daoud Mohamed, 2023. Le rôle des puits d'irrigation dans les transformations spatiales au Moyen Draa: cas de l'oasis de Mezguita et ses marges. Journal des sols, environnement et développement. 2 : 119-133 (en arabe). https://revues.imist.ma/index.php/TED/article/view/37467
Bahani Abdel Kabir, 2016. Région de Zagora et culture de la pastèque. Pp. 43-64 in Actes du colloque régional sur les oasis : enjeux du développement durable au Sahara marocain, les 21, 22, 23 novembre 2014, à Assa (en arabe).
Bounar A et Banane M., 2021. La culture des pastèques dans les territoires oasiens entre la fragilité des ressources en eau et les enjeux d’acteurs : cas de la Feija de Zagora. In « Les ressources en eau dans un contexte de variabilité climatique : gestion, mutations et enjeux de durabilité. Publications de la FLSH-Agadir. pp. 78-92.
Bentaleb, A. 2011. Pompage de l’eau et désertification dans la Vallée du
Draa moyen : cas de la palmeraie de Mezguita (Maroc). Revue Insaniyat, 51-52 : 65-81. https://journals.openedition.org/insaniyat/12576
Daoud M., 2000. Quelques nouveaux aspects de la dynamique de la gestion des ressources en eau dans la moyenne vallée de Ziz. Pp 133-150 in actes du colloque « Eau et environnement au Maroc aride et semi-aride ». Action intégrée1193/96, publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines El Jadida., Série colloques et séminaires n°2, el Jadida, 247 p.
Daoud M., 2019. Oasis en proie aux incendies : le cas de la moyenne vallée de Ziz, Sud-Est marocain. Pp. 241-254, in Géographie, Espace, Territoire et Société au Maroc: Mutations, Dynamiques et Enjeux. Publications de la Faculté de Lettres et des Science Humaines-Mohammedia, 686 p.
Khardi, A., Nogot A., Abdellaoui M., et Jaiti F. 2024. Valorisation des sous-produits du palmier-dattier pour contribuer à la durabilité des oasis du Maroc. Cahier Agriculture, 3-33 : 1-10
https://www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/pdf/2024/01/cagri230057.pdf
Hakkou A., Bouakka M., 2004. Oasis de Figuig: état actuel de la palmeraie et incidence de la fusariose
vasculaire. Science et changements planétaires/Sécheresse, 15: 147–158
Source wep par : Ait Ali Ahmed Abdeljalil et Daoud Mohamed
Les tags en relation
Dictionnaire scientifique
Plus de 123.000 mots scientifiques
Les publications
Géo parc Jbel Bani

Circuits & excursions touristiques

cartothéques


Photothéques
Publications & éditions




