Recherchez sur le site !
Recherche avancée / SpécifiqueCatégories publications
+ Sciences De La Terre - Archéologie - Astronomie - Spéléologie - Ecologie - Pédologie - Volcanologie - L'hydrogéologie - Géomorphologie - Minéralogie - Pétrologie - Paléontologie - Géologie + Climatologie - Réchouffement climatique - Changement climatique + Plantes - Plantes Aromatiques - Plantes médicinales + Zoologie - Faunes + Botanique - Flors + Sciences humaines - Géo Eco Tourisme - L’anthropologie - L'Histoire - Démographie - Sociologie - Géographie - Patrimoine culturel
Géo éco tourisme inclusif

Géoparc et Recherche Scientifique
Le coins de l’étudiant



Blog Géoparc Jbel Bani
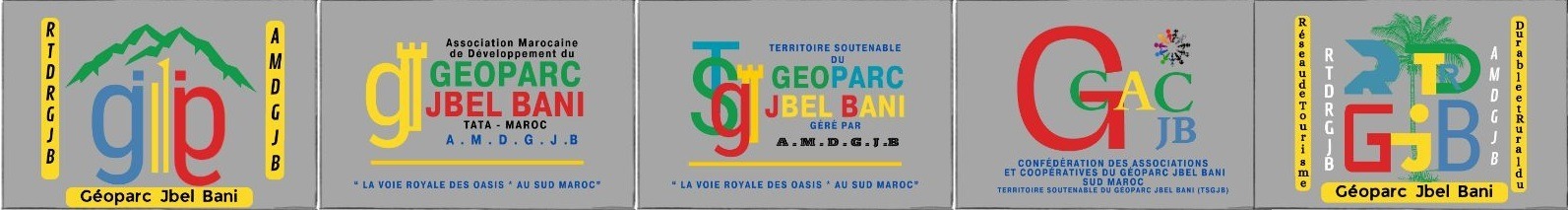
Quelle place pour l’expression proverbiale àJamaâ El Fna ?
Faïza Jibline,
Université Cadi Ayyad Marrakech
Résumé
Dans la présente contribution sur la place Jamaâ El Fna, comme lieu d‘expression, d‘épanouissement et de perpétuation de l‘oralité, je me propose de tester la validité de l‘hypothèse selon laquelle l‘expression proverbiale en général, s‘immisce à brûle-pourpoint dans pratiquement tous les autres genres de notre littérature, et se trouve par la même occasion impliquée à un degré ou à un autre dans la création orale qui caractérise la place. Pour ce faire, je partirai de quelques genres de la littérature orale connusà Jamaâ El Fna, afin de tester l‘impact du proverbe sur ce microcosme.
Survolons brièvement l‘histoire de la ville rouge et de sa place afin de comprendre les raisons profondes qui justifient, non seulement son existence -car ceci n‘est pas l‘apanage de Jamaâ El Fna1- mais surtout son aura à l‘origine de sa pérennité.
La naissance de la place est intimement liée à celle de Marrakech. Tous les livres sur l‘histoire du Maroc sont là pour en témoigner2. Le nom de Jamâa El Fna qui véhicule une grande incertitude quant à son origine, n‘a été adopté qu‘au 18ème siècle faisant oublier ses anciens noms, de « place » et de «grande place »3.
Economiquement parlant, la place a toujours été connue comme un lieu de rencontre, d‘échange et surtout de transactions commerciales, sans oublier celui de lieu pour les courses hippiques. A partir du 17ème siècle, elle devient aussi lieu de plaisir, et de distraction de toutes sortes avec l‘apparition des « halqa »4. C‘est surtout à partir de la 2ème moitié du 19ème siècle qu‘elle devient un lieu d‘expression cultuel par excellence5.
Marrakech en tant que cité n‘est entré dans l‘histoire du Maroc que tardivement au 11ème siècle. Elle s‘est dès le départ distinguée des autres villes marocaines par son site un peu spécial puisque se situant entre deux communautés arabe et berbère. « Ainsi, à la montagne berbère s‘oppose la plaine bédouine »6. Ce brassage de deux civilisations dans la cité des Almoravides donnera lieu à une culture populaire, résultat d‘une longue gestation des deux peuples en présence.
Par conséquent, le patrimoine culturel de Marrakech ne peut que refléter cet état de chose qui transparaîtra à la fois dans le fond et la forme de son patrimoine oral. Parlant de la vie intellectuelle de la cité des Almoravides, Deverdun dit : « la vie littéraire existait, mais elle était imposée et cheminait par les routes orthodoxes. Néanmoins elle contribuait à constituer dans cette ville, peuplée de berbères, un milieu intellectuel, de langue arabe, nécessaire au renom de la jeune capitale. »7
Nul doute que la culture orale d‘alors existait parallèlement et suivait le même itinéraire. Il est donc logique que le patrimoine calqué sur le schéma oriental exprime des préoccupations plutôt citadines, alors que l‘autre reflètera la mentalité des paysans nouvellement sédentarisés et tiraillés entre leur civilisation autochtone et celle prônée par le pouvoir central aliéné au modèle oriental.
Mais puisque l‘élite est somme toute minoritaire, c‘est la civilisation, la culture et le savoir-faire paysans qui prédomineront. En effet, et bien plus tard, au début du siècle dernier, Taraud dit en comparant Marrakech et Fès : « … il existe entre Marrakech et Fès la différence qui sépare une ville de haute bourgeoisie, avec tous ses raffinements, et une ville qui est restée profondément féodale. ».
C‘est essentiellement de cette profonde imprégnation de deux civilisations que naîtra la culture populaire orale de Marrakech, et qui s‘exprimera à travers des formes très variées mais toutes aussi intéressantes et attachantes les unes que les autres. Même actuellement, cette mosaïque des cultures en présence, représente l‘incessant et renouvelable programme que la place offre quotidiennement, et à longueur de journée à ses adeptes et visiteurs.
S‘agissant des personnes évoluant dans cet univers à longueur de journée, nous pouvons constater qu‘ils proviennent de différents horizons. Si dans leur grande majorité ils résident dans la ville, il en est qui restent itinérants. L‘exemple de Malik Jaluq (roi ferraille) est très édifiant à ce sujet. (Apparemment, il avait pour habitude de faire le trajet Marrakech-Casablanca à pied).
D‘autres figures emblématiques de la place, nées à Marrakech ou venues d‘ailleurs ont acquis leur notoriété nationale ou internationale, en tant qu‘artistes à partir de la place comme le chanteur arabophone Hamid Ezzahir, le grand poète et chanteur berbérophone Hadj Mohammad Ouahrouch, le conteur de renommée internationale Mohamed Bariz…
Tous ces personnages et bien d‘autres ont marqué la place à la fois par leur don artistique mais aussi par l‘impact certain qu‘ils ont eu sur ses habitués. C‘est en effet à travers le côtoiement de tels personnages, que leurs disciples ont acquis cette expérience unique, consistant à allier l‘expression plaisante et joviale avec la sagesse et la maturité.
Dans ce magma linguistique qui passe du chant, sous toutes ses formes au contage dans ses différentes expressions, sans oublier toutes les autres manifestations orales, les protagonistes des « halqa » sont, à mon avis volontairement ou involontairement en contact permanent avec l‘expression proverbiale.
En effet, lors de la communication, le proverbe est cette séquence qui se place insidieusement dans la chaîne parlée et surgit comme un argument ou un commentaire ou une exhortation. Il peut alors émaner d‘un conte, d‘une chanson, d‘une devinette, d‘une anecdote, et que sais-je encore ? Alors essayons de voir cela et prenons à ce sujet quelques exemples édifiants dans le domaine très prisé de l‘humour.
Si nous regardons de près les humoristes de la place, nous constatons que comme beaucoup de Marrakchis, ce sont des êtres affables, portés sur le rire et le divertissement. La seule école qu‘ils aient connue est la rue où ils ont appris à être eux-mêmes, c‘est-à-dire des êtres marqués par la recherche du plaisir exprimé à travers le rire. Ce penchant avéré pour l‘humour, en général, et le comique en particulier en fait des individus à la répartie aussi vive que facile. Ils rechercheront alors tout le temps ces moments de joie qu‘ils ne trouveront qu‘auprès des autres humoristes qui les ont précédés sur la place10.
Cette envie de rire avec l‘autre, de le faire rire et pourquoi pas d‘en rire est si tenace qu‘ils en feront leur cheval de bataille et aussi leur gagne-pain et ne s‘exprimeront alors qu‘à travers l‘humour.
Pour atteindre leur but, ils ne pourront compter que sur leur outil linguistique et leur bagage culturel oral doté d‘une panoplie d‘anecdotes, d‘histoires drôles, de rumeurs, d‘historiettes qu‘ils enjoliveront chacun selon son penchant et ses capacités- de mots d‘esprit, de proverbes et de figures de styles. Les grands humoristes de la deuxième moitié du 20ème siècle et tant d‘autres, comme Baqchich, Flifla, Malik Jaloq, Mikhi, Tbib Lhacharat,, Mul Lhmar, Sarukh etc., ont tous marqué la place par leur présence et chacun à sa manière.
Flifla (piquant) par exemple représente le type même de l‘humoriste traditionnel. Son domaine de prédilection est l‘anecdote populaire. Toujours affublé de son luth fétiche qu‘il n‘utilisait jamais, il avait l‘art de raconter des anecdotes plus ou moins récentes, mais qu‘il avait le génie d‘actualiser continuellement de sorte que le public se tordait de rire et partait satisfait après chaque représentation.
Cet artiste né excellait dans l‘art de mettre en scène tous les personnages des anecdotes qu‘il racontait ; il recourait alors à des historiettes du type : /məsmar žḥa / (le clou de Jeha), / ḷḷahəmma fijja wala fik a ṣṣfiṛa bnijti/ (tans pis pour moi pourvu que vous soyez épargnées oh ! mes jaunettes !) ou / flus llbən ddahum zəcṭuṭ / (le singe a pris l‘argent du petit lait). Ces anecdotes et bien d‘autres encore, consacrées par la tradition populaire, faisaient partie de son répertoire.
En effet, qui à Marrakech et même ailleurs ne connaît pas au moins une de ces trois anecdotes ? Dans la première, Jeha met en location sa maison à l‘exception d‘un clou sur le mur qu‘il utilise comme prétexte afin de rentrer à la maison quand il veut et contre l‘avis du locataire.
La deuxième raconte l‘histoire du paysan arabe qui, par peur de déchirer ses babouches, les met dans son capuchon, et lorsqu‘il écrabouille son orteil en trébuchant, il s‘écrie : « tant pis pour moi, pourvu que vous soyez épargnées oh ! mes jaunettes ! »
La troisième est celle du berbère qui, après avoir passé la journée à vendre le petit-lait se rend à Jamâa El Fna et s‘installe devant l‘attrayante « halqa des singes ». Ces derniers sont si drôles qu‘il n‘hésite pas à leur donner un réal puis un autre. Lorsque de retour chez lui sa femme s‘enquit de son gain de la journée, il lui répond naïvement que le singe a pris l‘argent du petit-lait.
Il reste à remarquer que ces anecdotes sont si connues, parce que très galvaudées qu‘elles se figent et finissent par se muer en proverbes et / məsmar žḥa / se dira de celui qui cherche à berner quelqu‘un, / ḷḷahəmma fijja wala fik a ṣṣfira bnijjti / marquera l‘ironie à l‘intention d‘un radin, et / flus llbən ddahum zəcṭṭuṭ/ se dira de celui qui gaspille facilement ce que lui ou d‘autres ont gagné laborieusement.
Toutes ces phrases intégrées dans le domaine proverbial renvoient en fait à des événements de la vie quotidienne que l‘usage a figées afin de devenir des exemples que tout membre de la communauté peut utiliser chaque fois qu‘une situation similaire les rappelle à sa mémoire. Et même si dans la majorité des cas les anecdotes qui leur servent de supports dépérissent et tombent en désuétude, les expressions devenues proverbes restent vivaces tant que l‘imaginaire populaire est là pour les activer et les perpétuer. Car « Pour ce genre de citation, le temps est souvent le meilleur allié. »11
Mon but dans ce papier était de tester l‘existence de l‘expression proverbiale sur la place. Or je me rends compte que celle-ci est inextricablement liée au quotidien de tous ceux qui y évoluent depuis les artistes jusqu‘aux commerçants en passant par les visiteurs et habitués.
En fait, l‘expression proverbiale en général et le proverbe en particulier est cette parole venue de nulle part, mais qui peut nous influencer en nous persuadant ou en nous dissuadant de faire quelque chose :
Exemple : la tfrəḥ b rrzəq ḥətta txrah « ne te réjouis d‘une manne que lorsque tu l‘auras déféquée » proverbe ayant pour origine une histoire animalière. Il sous- entend qu‘il ne faut pas crier victoire trop tôt.
Elle peut aussi choisir pour nous ce qui est conforme au canevas social ; exemple : sənca ila ma ğnat tstər waquila tzid f ləcmər : « le métier qui n‘enrichit pas met à l‘abri du besoin et peut même prolonger la vie ». Proverbe ayant pour origine un conte et faisant l‘apologie de l‘apprentissage d‘un métier.
Mais ne nous leurrons pas et méfions-nous de cette formule lapidaire car elle est capable de nous mettre face à nos responsabilités ; exemple : lli darha b idih ifəkkha b sənnih « celui qui fait un nœud de ses mains n‘a qu‘à le défaire avec ses dents. » (Proverbe contenu dans l‘une des chansons de Hamid Ezzahir.)
Et l‘on peut multiplier les exemples dans la mesure elle où elle peut aussi nous inciter à faire prévaloir notre esprit d‘initiative, notre expérience et nos capacités personnelles car elle est l‘expression de notre mémoire collective par excellence, et les adeptes de la place sont confrontés à cette réalité quelle que soit la halqa qu‘ils choisissent et quelle que soit la langue véhiculaire de celle-ci.
Enfin, si l‘on peut dire que l‘identité culturelle d‘un peuple se reflète à travers l‘usage que chaque communauté réserve à son patrimoine, la place est alors le lieu qui permet à chacun de ses visiteurs de conter sa propre solitude. Elle est grâce à ses « halqa » en perpétuel renouvellement, le lieu de notre mémoire collective, qui s‘exprime à travers l‘appellation Jamâa El Fna qui au gré des désirs peut devenir
« Jamâa rrbəḥ » et pourquoi pas « Jamâ ləklam ».
Concordances phonétiques
|
Signe arabe |
Signe phonétique |
Exemple en arabe |
Exemple en français |
|
ゆ |
b |
bit ( chambre ) |
balle |
|
れ |
t |
taman ( prix ) |
tasse |
|
ァ |
ž |
žb¶l ( montagne ) |
jouet |
|
ゥ |
ḥ |
ḥit ( mur ) |
|
|
ォ |
x |
xux ( pêche ) |
|
|
キ |
d |
dar ( maison ) |
dé |
|
ケ |
r |
rmad ( cendre ) |
|
|
コ |
z |
zlafa ( bol ) |
zèbre |
|
サ |
s |
s¶llum ( échelle ) |
souris |
|
ス |
š |
š¶rž ( selle ) |
chameau |
|
ソ |
ṣ |
ṣufa ( laine ) |
|
|
チ |
ḍ |
ḍ¶ll ( ombre ) |
|
|
ヅ |
ṭ |
ṭir (oiseau) |
|
|
ネ |
c |
cud ( bois ) |
|
|
パ |
ğ |
ğaba (forêt) |
|
|
フ |
f |
far ( souris ) |
Four |
|
ベ |
q |
q¶rd (singe) |
|
|
ポ |
k |
kas (verre) |
colle |
|
メ |
l |
lil ( nuit) |
loup |
|
ュ |
m |
mut ( mort) |
Mal |
|
ラ |
n |
nab (canine) |
Nuit |
|
ロ |
h |
hiba (don) |
|
|
گ |
g |
g¶lb (cœur) |
gâteau |
2- Les voyelles
|
أ |
a |
ḥanut (boutique) |
ami |
|
أ |
u |
už¶h (visage ) |
cou |
|
ま |
i |
ibra (aiguille) |
lit |
|
|
¶ |
tm¶ṛ (dates) |
petit |
|
ء |
? |
?aš (quoi) |
|
3- Les semi-voyelles
|
ヱ |
w |
wali (tuteur) |
jouissance |
|
ヵ |
j |
maj (mai) |
paille |
Le 31/12/2024
Source Web par : Livre "De l’immatérialité du patrimoine culturel"
Les tags en relation
Dictionnaire scientifique
Plus de 123.000 mots scientifiques
Les publications
Géo parc Jbel Bani

Circuits & excursions touristiques

cartothéques


Photothéques
Publications & éditions




