Recherchez sur le site !
Recherche avancée / SpécifiqueCatégories publications
+ Sciences De La Terre - Archéologie - Astronomie - Spéléologie - Ecologie - Pédologie - Volcanologie - L'hydrogéologie - Géomorphologie - Minéralogie - Pétrologie - Paléontologie - Géologie + Climatologie - Réchouffement climatique - Changement climatique + Plantes - Plantes Aromatiques - Plantes médicinales + Zoologie - Faunes + Botanique - Flors + Sciences humaines - Géo Eco Tourisme - L’anthropologie - L'Histoire - Démographie - Sociologie - Géographie - Patrimoine culturel
Géo éco tourisme inclusif

Géoparc et Recherche Scientifique
Le coins de l’étudiant



Blog Géoparc Jbel Bani
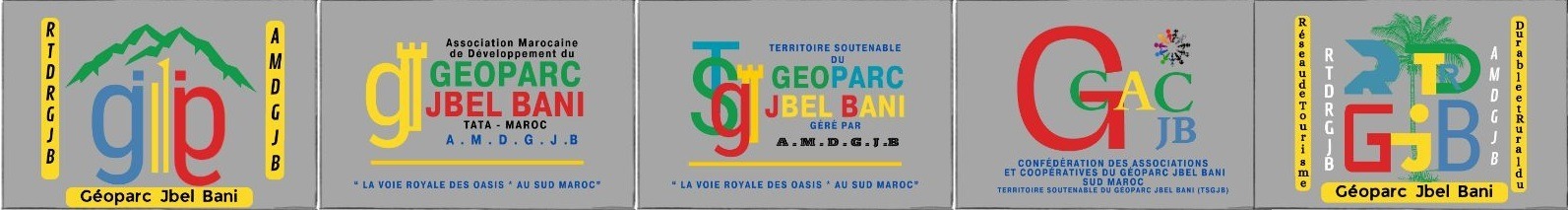
Quand le conteur raconte la femme sur la place Jamaâ El fna
Hayat Kertaoui
Université Cadi Ayyad Marrakech
Résumé :
Jamaâ El Fna fut de tout temps une source de vie, un lieu de distraction mais aussi un espace préservant la pérennité de la culture populaire marocaine en général et marrakchie en particulier, c‘est un contexte énonciatif perpétuellement en mouvement tant ses données énonciatives demeurent plurielles et changeantes. Dans cette communication, nous tenterons d‘étudier, à la lumière de la théorie de l‘énonciation, la représentation de la femme dans les contes racontés sur la Place Jaâ El Fna et qui semblent rompre paradoxalement avec la portée argumentative misogyne de la culture populaire marocaine.
Jamaâ El fna fut de tout temps une source de vie, un lieu de distraction mais aussi un espace permettant de sauvegarder la culture populaire marocaine en général et marrakchie en particulier : proverbes, expressions figées, devinettes, chants, contes… autant de composantes de cette culture, devant aussi leur pérennité à cette place qui s‘est érigée, par de là ses spécificités socioculturelles, en un véritable carrefour où interfèrent plusieurs cultures.
Pourtant, la mémoire populaire semble faire preuve d'une certaine ingratitude à l'égard de cet espace nourricier qui n‘a cessé de donner à la ville. Un bref regard sur le répertoire injurieux du parler marrakchi montre à quel point ce lieu a servi de référence pour alimenter tout un paradigme d'expressions injurieuses relatives à la débandade, à la malhonnêteté et à la mauvaise éducation : (fils de Jamaâ El fna), (éducation de Jamaâ El Fna).En effet, la grammaire des insultes propres au parler marrakchi met en exergue la portée argumentative, combien dépréciative et dénigrante de ce paradigme.
Il ne faudrait donc pas s'étonner si les femmes marrakchies "bien élevées" ne fréquentent pas ce lieu, lié dans l'imaginaire de la ville, à certaines pratiques vues comme transgressant les normes et les valeurs institutionnelles de cette dernière (Moechler, 1985)
Un tel regard ne semble pas correspondre aux normes tacites régissant la fréquentation de ce lieu où la femme jouit paradoxalement, et de façon inhérente à cet espace de transgression, d'une liberté exceptionnelle, quasiment impossible dans les autres espaces de la ville. En effet, beaucoup de femmes peuvent se balader tranquillement, sur la place, en dégustant un sandwich à une heure tardive du soir, sans qu'elles aient besoin d'une escorte masculine. Jamâa El Fna, en dépît de ce regard généralement peu appréciatif des habitants de la ville, se présente de par ce fait comme un lieu de tolérance et d‘ouverture, un espace que l‘autre peut aussi s‘approprier et en faire sien.
En effet, malgré les préjugés dont nous avons déjà parlé, « l‘esprit Jamaâ El fna » semble être fondé sur le respect de la liberté de l‘autre, que ce soit dans le partage de l‘espace, dans le rapport au public ou encore à l‘activité pratiquée. Nous serons presque tentées de dire que Jamaâ El Fna à cet égard est une grande « huma » (quartier) protégée et préservée par la morale de la « huma ». C‘est dans ce sens que cet endroit constitue paradoxalement un espace de liberté pour la femme. Cet esprit humaniste de la place semble rompre avec la dimension misogyne de la culture populaire marocaine préservée et sauvegardée aussi par le dynamisme de ce lieu. N‘ayons pas peur des mots : la culture populaire marocaine est véhiculaire de toute une idéologie misogyne voyant en la femme un être satanique, inconscient et irresponsable. Seule la mère, être vénéré, échappe à cette grammaire des insultes que nous retrouvons clairement dans plusieurs composantes de cette culture ; les expressions figées et le discours proverbial sont le témoignage vivant d‘une telle vérité (ce n‘est qu‘une femme (paroles de femmes donc mal fondées), (affaires de bonnes femmes) (la femme et l‘ânesse ne sont jamais reçues en tant qu‘invitées, partout où elles vont, il faut qu‘elles travaillent…) La visée argumentative de ces expressions dénonce le regard peu valorisant de la société marocaine à l‘égard de la femme, lequel regard assoit l‘idéologie misogyne véhiculée par la culture populaire.
Ce parallélisme entre un Jamaâ El fna, espace de liberté pour la femme et un Jamaâ El fna, foyer d‘une culture populaire misogyne, nous a donné l‘envie d‘interroger les contes racontant la femme sur cette place où l‘acte d‘énonciation, qui est en l‘occurrence l‘acte de raconter, se distingue par la pluralité des facteurs énonciatifs généraux qui régissent ce dernier. En effet , le contexte est pluriel, l‘allocutaire est pluriel, la situation de l‘énonciation change au rythme des arrivées et des départs incessants des allocutaires, la trame narrative se renouvelle continuellement tant elle dépend de cet allocutaire changeant et éphémère qui reçoit souvent le message à un moment donné de la narration ; le conte devient , sous l‘impact de la complexité de tous ces facteurs énonociatifs, polyphone et surinterprétatif , à l‘image même de cette dynamique qui régit la relation entre la transmission et le décodage du conte sur la place.
Soulignons d‘emblée que la femme ne constitue pas le sujet dominant des contes racontés sur la place. Elle est présentée, au-delà de l‘importance du rôle joué, en fonction de son apport à l‘homme.
Le répertoire des conteurs qui continuent, aujourd‘hui encore à animer des halqas comme, Mohammed Bariz, Abderrahim Al Moqri, Rghibi, tourne autour de thèmes variés et s‘inspire de sources plurielles dont la religion, l‘histoire, les mythes, la mémoire populaire, la vie de tous les jours… Les habitués des halqas s‘accordent pour louer cette capacité qu‘ont les conteurs de la place à voyager dans le temps, à faire ce nomadisme fantastique entre la réalité et le mythe. Par la magie du verbe, le conteur transforme une réalité historique en une légende qui peut à son tour trouver un ancrage dans l‘actualité. C‘est ainsi donc que la femme, qu‘elle soit personnage historique, mythique, religieux ou faisant simplement partie du commun des mortels, est incessamment repensée et réinventée par le conteur de la place, selon la complicité qui le lie à son public et selon le contexte socioculturel régissant le contage. Cette complicité, c‘est ce que Grice (1979) appelle : « le principe de coopération » ; qui n‘est autre que le partage d‘un vécu et d‘un héritage socioculturel capable de créer une certaine connivence entre les différents sujets parlant.
« De Belkis et le trône » à « Zineb la sauvage » ou en passant encore par « la vieille est plus rusée que Satan », le conteur recrée à chaque fois la femme. D‘un public à un autre, d‘un conteur à un autre, le conte est à chaque fois une nouvelle appropriation du féminin. Ceci est d‘autant plus révélateur que le comptage autour de la femme sur la place Jamaâ El fna se fait quasiment en l‘absence de la femme, En effet, les conteurs de la place sont tous des hommes et leur public est essentiellement masculin. Pour ne citer qu‘un cas de figure, une halqa, repérée à l‘œil nu et qui est composée de 31 auditeurs, comprend 7 enfants, 10 jeunes garçons et 14 adultes (hommes). On comprend aisément devant de telles données énonciatives que quand le locuteur raconte la femme sur la place, c‘est avant tout un discours d‘homme à hommes, ce qui se traduit par un ensemble de clins d‘oeils s‘adressant à l‘allocutaire averti qui comprend la dimension inductive des stratégies argumentatives utilisées par le conteur. Ce genre de procédés énonciatifs renforcent la complicité entre ce dernier et son auditoire et donne libre cours à certaines formules du genre : (et notre ami n‘est qu‘un homme, donc un être vulnérable et sans défense devant la ruse de la femme), (Ces jeunes filles incapables de trouver du travail, donc incapables de trouver un mari). Ces expressions s‘adressent à un allocutaire complice, capable de décoder leurs dimensions implicites et la charge pragmatique dont elles sont dotées.
Ces formules empruntées à Rghibi provoquent souvent le sourire complice de ses allocutaires qui, à force de partager ce discours, décodent à sa juste valeur et selon l‘orientation argumentative choisi par le conteur toute la dimension non-dite du conte.
Signalons toutefois que ce discours prend une tournure différente dès que la halqa est alimentée par la présence des femmes, surtout quand ces dernières ont un profil de femmes instruites : "Café de France (N‘oublions pas que Jamaâ El Fna fait partie des mille et une nuits, il y avait une femme qui avait un public très important, elle donnait des conseils judicieux aux gens, elle s‘appelait Fatima la noire . Sa halqa se tenait tous les soirs, devant le café de France). Notons à cet égard, que les contes racontant les histoires des femmes érudites en matière de religion, des femmes dotées d‘une grande sagesse et d‘une grande clairvoyance bénéficient d‘un intérêt particulier de la part du public qui les sollicite avec la même ferveur que les histoires des saints, des prophètes, des grands personnages mythiques ou historiques. En effet, ces contes alimentent le répertoire des conteurs encore présents sur la place comme :
La fille du bûcheron
Le jeune homme et les trois sœurs ( la femme, son mari et le porteur d‘eau) Comme l‘atteste le répertoire de Bariz ; dans ce celui de Rghibi, nous retrouvons outre les contes pré-cités, (Le conseil des parents c‘est l‘entraide entre l‘homme et la femme) " (Zineb, la fille de la jungle) L‘omniprésence des prénoms féminins dans les contes de la place renforce cette démarche argumentative inductive, comme c‘est le cas pour le ―malhoun ― où tout un paradigme de prénoms marocains caractéise les titres des qsida‖; ce recours aux prénoms vise à donner aux femmes un certain corps, un certain ancrage dans la réalité, ce qui rendrait encore plus attrayante la relation liant le conteur à son public.
Ainsi, dans la fille du « bûcheron et le roi », souvent raconté par M. Bariz, c‘est la fille du bûcheron qui élucidera le rêve énigmatique du roi qui, appréciant sa sagesse et sa clairvoyance, décida de l‘épouser et de faire d‘elle sa conseillère dans la gestion des affaires de son royaume, bien qu‘elle ‘nn’‘ait ni membres inférieurs, ni membres supérieurs.
Dans « la femme, son mari et le porteur d‘eau » Mohammed Bariz commence son conte par la formule suivante :
« IL était une fois un commerçant qui était marié avec une femme pieuse et intègre et ils étaient amoureux l‘un de l‘autre. »
Le conteur, se comportant en fin psychologue, présente au public de la place, l‘idéal féminin recherché avec beaucoup de nostalgie, comme nous le verrons plus tard.
Le profil féminin raconté en général sur la place se révèle assez revalorisant et très élogieux à l‘égard de celle qui n‘a cessé d‘être considérée par la culture populaire que comme « un deuxième sexe. » En effet, hormis certains contes parmis lesquels nous citerons le cas de figure le plus dominant :
« La femme rusée » comme (La vieille et le Satan) et d‘autres qui s‘inscrivent dans la même visée argumentative, les allocutaires de la halqa sont surtout friands d‘héroïsme et particulièrement nostalgiques d‘une époque qui n‘est plus.
En effet, le public est manifestement en quête de ces héroïnes hors-normes, incarnant un idéal féminin puisant sa substance à la fois dans un héritage culturel religieux, historique et mythique, encore très présents dans la mémoire collective :
Tous ces contes brossent des portraits très diversifiés de la femme, allant du profil héroïque à la femme savante et sage en passant par la femme rusée ou naïve.
Quel que soit le profil conté, nous avons remarqué que le conteur de la place adopte un discours respectueux et pudique même dans les passages les plus érotiques d‘un conte, voire, il privilégie les contes présentant la femme comme un exemple de sagesse, d‘érudition et d‘intégrité.
De ce fait, les contes racontant la femme sur la place Jamaâ El fna marquent une rupture avec la dimension misogyne des autres composantes de la culture populaire. Dans ce sens, nous aimerions citer des témoignages recueillis sur place par des étudiants préparant leurs mémoires de licence autour la place Jamaâ El fna : Abdel Hakim El Hamzaoui, chanteur de « Tqitiqat » sur la place crie à qui veut l‘entendre :
(La femme moderne ne prépare pas à manger selon les normes de notre cuisine, tout le temps habillée en mini-jupe, elle me fait honte dans le quartier, en plus elle ne sait ni lire ni écrire et elle sent mauvais ».
Si Brahim (42 ans), faisait partie d‘une troupe de Wlad Sidi Moussa (Il y a des filles dévergondées qui portent des jeans et des mini-jupes, il ne leur reste plus qu‘à se mettre nues).
On comprend aisément comment le conteur, en fin psychologue, essaie de rompre avec ce genre de pratiques énonciatives et avec la mentalité populaire dominante sur la place, en offrant à son public le change : le profil féminin tant rêvé et tant désiré. la dualité entre la modernité et l‘authenticité, préoccupation principale de la culure marocaine contemporaine, est perçue comme mal approchée par certaines femmes pour qui, « être moderne » signifierait « entrer dans un processus d‘acculturation handicapant et dévalorisant ». Le rapport conflictuel entre une authenticité menacée et une modernité mal assumée par les femmes n‘a pas laissé indifférents plusieurs acteurs de la Place, comme le montrent clairement les citatations pré-citées. Leurs visées argumentatives fortement injurieuses n‘hésitent pas à blesser la femme dans sa féminité devant un public essentiellement masculin, en l‘accusant d‘être sale au point de sentir mauvais.
Bariz, Rghibi, Sghir, Abouchama, Almoqri et d‘autres, en racontant la femme sur la place, tiennent en général un discours allant aux antipodes du discours misogyne populaire. Seulement, en revalorisant incessamment la femme à travers ces super-women, ils continuent à nourrir les rêves et les sentiments nostalgiques du public. Une telle réalité nous semble d‘autant plus délicate que le conteur est à sa manière aussi un enseignant, un enseignant qui prêche « au pied du temple » - pour reprendre cette belle expression d‘Ahmed Taoufiq. En effet, cette mission du Conteur-Maître est d‘autant plus intéressante qu‘elle est consolidée aussi par le rôle prépondérant que joue ce dernier dans la transmission de l‘écrit à l‘oral. En inscivant l‘écrit dans l‘oralité, le conteur soumet le conte à plusieurs transformations linguistiques et discursives afin que son message soit accessible à un public large, ayant des niveaux d‘instruction très différents et qui peut être même analphabète. Dans ce jeu narratif, les mécanismes énonciatifs, régissant le contexte énonciatif dans lequel opère l‘acte de conter dans ce lieu, deviennent complexes tant ils inscivent le conte hors du temps en transgressant les contraintes de ce dernier comme élément de l‘histoire. Néanmoins, ces changements et ces métamorphoses qui s‘opèrent sur le conte et qui sont en partie le produit d‘une énonciation qui se renouvelle perpétuellement, sont les signes de la vitalité d‘un genre dont les autres espaces de narration se font de plus en plus rares. Le grand mérite des conteurs mais aussi l‘acte le plus généreux de cette place nourricière résident dans le fait que grâce aux halqas, aujourd‘hui, le public analphabète connaît Antar, les mille et une nuits, Al Azalya, la biographie des saints et toutes ces figures féminines qui continuent à faire rêver nos hommes et nos femmes. L‘idéal féminin véhiculé par les conteurs considérés comme des figures emblématiques de la place relève certes de la fiction, néanmoins, entre le réel et l‘irréel, il y a toujours une part de vérité, celle que le conteur sait s‘approprier et transmettre à son auditoire en véritable maître. Par les mécanismes discursifs utilisés, par l‘orientation du récit vers une visée argumentative bien déterminée et par son aptitude à interpeler ses auditeurs en fonction des conditions énonciatives régissant l‘acte de conter, le conteur acquièrt une certaine autorité sur son public. Le conteur dont le pouvoir est inextricablement lié à la magie du langage et à cet héritage culturel immatériel, assure, en créant ce lien viscéral avec son public, la fidélité de ce dernier envers cet espace magique qu‘est la place Jamâ El Fna.
Bibliographie
BELMONT, N. Poétique du conte, Gallimard, Paris, 1999. DUCROT, O. et al. 1980. Les mots du discours Paris Minuit
MOESCHLER, J. 1985. Argumentation et Conversation Eléménts pour une analyse pragmatique du discours L.A.L. Paris Hatier- Crédif
SKOUNTI, A. & TEBBAA, O. 2005, Place Jemaâ El Fna. Patrimoine Culturel Immatériel de Marrakech, du Maroc et de l’humanité, Rabat: Bureau de l‘UNESCO.
Le 02/01/2025
Source Web par : Livre "De l’immatérialité du patrimoine culturel"
Les tags en relation
Dictionnaire scientifique
Plus de 123.000 mots scientifiques
Les publications
Géo parc Jbel Bani

Circuits & excursions touristiques

cartothéques


Photothéques
Publications & éditions




